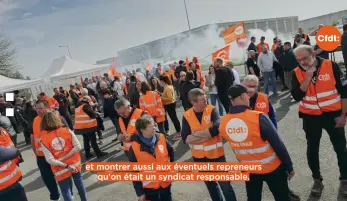Pour une alimentation durable ancrée dans les territoires
Cet avis a été co-rapporté par Albert Ritzenthaler, du grope CFDT, et Florence Denier-Pasquier, du groupe Environnement Nature. Les deux groupes ont fait une déclaration commune.
L’alimentation doit être reconnue comme un secteur stratégique national ancré durablement
dans les territoires. Voilà comment nous pourrions résumer, en une phrase, ce travail qui était très
attendu dans notre section depuis l’avis « fracture et transitions comment réconcilier la France ».
Cet avis est essentiel car il est à la croisée des enjeux et des urgences : la modification des pratiques
agricoles industrielles pour assurer la transition agroécologique, le « poids climatique » de notre
assiette qui représente ¼ de notre empreinte carbone totale, la précarité alimentaire qui implique
désormais de trouver d’autres recettes que l’aide alimentaire actuelle, la malbouffe, qui oblige à une
véritable convergence entre santé et environnement, ainsi que l’attractivité des métiers agricoles. Et
la crise COVID a rappelé une dimension supplémentaire : le besoin d’autonomie alimentaire des
territoires, au plus près des consommateurs.
En réponse à ces enjeux, l’avis propose de repartir des fondamentaux : quels sont nos besoins en
protéines végétales et animales pour être en bonne santé et comment les territoires peuvent y
répondre durablement ? Pour répondre à cette question, l’avis articule toutes ses préconisations
autour du concept de la démocratie alimentaire. La démocratie alimentaire, au plus près du terrain,
est effectivement la bonne approche pour une transition juste qui articule économie locale et
préservation de l’environnement, tout en participant à la cohésion sociale.
Car il ne peut exister d’alimentation durable sans prise en compte de cette dimension sociale. En ce
sens, l’avis préconise de reconnaître la haute valeur sociale de l’emploi, notamment en favorisant
l’emploi local et en intégrant les enjeux sociaux dans les cahiers des charges des signes officiels de
qualité.
Les Maisons de l’alimentation durable doivent offrir une information éco-citoyenne et s’associer à une
compétence « alimentation durable » au sein des communes. Ces maisons devront devenir les têtes
de pont des acteurs de l’alimentation durable pour amplifier les Projets alimentaires territoriaux.
La préconisation 3 propose de s’appuyer sur les monnaies locales complémentaires pour valoriser les
productions agroécologiques et les rendre accessibles à tous, y compris aux personnes en précarité
alimentaire. Encore anecdotiques car peu déployées, ces monnaies citoyennes méritent d’être mieux
connues et confortées, car elles sont un véritable outil de démocratie territoriale au service du lien
social et des écosystèmes alimentaires.
L’avis expose sans détour la mise en œuvre d’une nécessité désormais partagée : moins de viande et
de poisson dans notre assiette, mais de la viande et du poisson de qualité ! Les protéines issues des
légumineuses doivent prendre le relai et cela peut et doit se conjuguer avec de nouveaux plaisirs de la
table. La préconisation 16 vise à le démontrer, et nous a permis au passage de résoudre un débat
récurrent dans notre section : la proposition d’un repas végétarien par semaine dans les cantines. Mais
attention : on parle d’un vrai repas végétarien, cuisiné avec des produits de proximité, et bon au goût,
car, oui, bon et végétarien, c’est possible, si certains en doutent encore !
Des moyens devront être mobilisés pour financer ces mesures et le développement des filières
agricoles associées. Les Projets Alimentaires Territoriaux devront bénéficier du volet dédié du plan de
relance mais aussi d’un financement par la Banque des territoires qui doit d’abord profiter aux
entreprises locales. La Politique Agricole Commune devra être révisée comme le propose la
préconisation 14, afin de réorienter nos productions alimentaires vers la transition agroécologique et
de prendre en compte l’emploi et en particulier la situation des salariés saisonniers. Le Fond social
européen+ est également à mobiliser pour organiser, à l’échelle des territoires, des actions de lutte
contre la précarité alimentaire qui associent habitants bénéficiaires et producteurs.
Enfin, cet avis reprend des recommandations déjà votées au CESE pour les amplifier : une loi foncière
qui mette en cohérence politiques d’aménagement et alimentation durable, la meilleure application
de la LOI EGALIM , la valorisation et le partage des recommandations du nouveau Programme National
Nutrition Santé, ou encore la construction d’un socle environnemental pour les labels et signes officiels
de qualité ainsi que l’émergence d’un nouveau label officiel, très attendu, qui articulera Agriculture
Biologique avec production locale et équitable !
En synthèse, cet avis incarne une vision de notre alimentation comme solution aux excès et gaspillages
climaticides des uns et à la précarité alimentaire des autres. Il propose de renouer avec les producteurs
proches de chez nous, sur des modes agricoles durables et organisés en réseau pour répondre à la
commande publique et aux consommateurs. Cet avis nourrit ainsi, au travers des Projets Alimentaires
Territoriaux, l’aspiration de rendre nos territoires plus résilients, plus humains et plus solidaires. Et,
dans cette période si difficile, nous souhaitons que cette vision devienne réalité au plus tôt.
Nous tenons à remercier les deux rapporteurs pour l’énorme travail d’auditions qui a
considérablement enrichi nos débats. Voter cet avis, ce que nous ferons bien sûr, c’est donner un réel
espoir à nos concitoyens qu’ils vivront plus sainement dans les territoires qui bénéficient de Projets
alimentaires territoriaux. Et c’est, dans le même temps, rappeler aux élus que ces PAT sont des
solutions de cohésion sociale et de développement d’emplois relocalisés.
En cela, cet avis nous semble une très belle pierre à mettre au service de l’édification du monde
d’après.