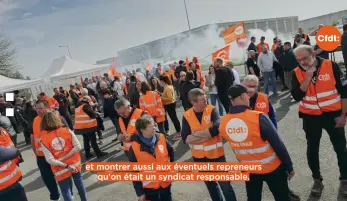
Handicap : Ouvrir toutes les portes des entreprises
• En 2019, une personne handicapée a trois fois moins de chances que la moyenne des travailleurs d’être en emploi et est deux fois plus exposée au chômage.
• Le gouvernement a présenté le 18 novembre les axes de sa stratégie interministérielle en faveur de l’emploi des personnes handicapées.

Trente ans après la loi de 1987 imposant à tous les employeurs publics et privés occupant au moins 20 salariés de recruter au minimum 6 % de travailleurs handicapés, le constat est sans appel : dans le dernier rapport du Défenseur des droits, le handicap apparaît pour la deuxième année consécutive comme la toute première cause de discrimination à l’emploi. Selon les chiffres de la Dares (direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques), le taux d’emploi direct dans le secteur privé est de seulement 3,5 %. En 2019, 515 000 demandeurs d’emploi sont en situation de handicap.
Muriel Pénicaud, ministre du Travail, Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des personnes handicapées, et Olivier Dussopt, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics, ont choisi la 23e édition de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (du 18 au 24 novembre 2019) pour installer, en présence des partenaires sociaux, le comité national de suivi et d’évaluation de la politique d’emploi des personnes handicapées. Ils ont également présenté leur stratégie interministérielle pour l’insertion et le maintien en emploi des travailleurs en situation de handicap, fruit de dix-huit mois de concertation avec les partenaires sociaux, les employeurs et les associations représentatives du secteur.
Une meilleure complémentarité des acteurs
Mise en place d’un comité de suivi Le comité national de suivi et d’évaluation de la politique d’emploi des personnes handicapées mis en place le 18 novembre dernier par Muriel Pénicaud, ministre du Travail, Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des personnes handicapées, et Olivier Dussopt, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics, a été unanimement bien accueilli et, pour cause : il rassemble à la fois les acteurs et les associations du secteur, des parlementaires et les partenaires sociaux. Le comité se réunira deux fois par an. « Un tableau de bord servira de pilotage avec des indicateurs, dont certains sont encore à construire, a précisé Muriel Pénicaud. C’est aussi un laboratoire d’expérimentations. Il faut ouvrir toutes les portes. » |
Le gouvernement souhaite créer un véritable « service public de l’entreprise inclusive », ce que Sophie Cluzel a précisé à l’aide de quelques mots-clés : « parcours, simplification et portabilité des droits ». Ce nouveau service s’appuiera localement sur une plus forte complémentarité des acteurs afin d’augmenter le niveau de qualification des personnes en situation de handicap (et faire doubler le nombre d’apprentis d’ici à 2022), simplifier les démarches et les procédures administratives donnant droit à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et mettre en place un accompagnement plus adapté en coordination avec les Esat (établissements et services d’aide par le travail), le service public de l’emploi et les organisations territoriales.
L’idée est de permettre une montée en compétences des salariés en milieu « ordinaire ». Pour cela, le gouvernement mise sur « la refondation de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, issue de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel de septembre 2018 [et applicable] dès le 1er janvier 2020 », a souligné Sophie Cluzel.
Mobiliser tous les employeurs
Pour Olivier Leclercq, secrétaire confédéral chargé du dossier, « il y a indéniablement dans cette loi des points positifs en vue de mieux responsabiliser les employeurs ». Ainsi, le nouveau cadre législatif change les modalités de calcul : le taux de 6 % reste le même mais, dorénavant, le calcul ne prendra en compte que les emplois directs. De plus, le décompte qui permet de déterminer l’obligation d’emploi devra être réalisé au niveau de l’entreprise et non plus de l’établissement, et les entreprises de moins de 20 salariés seront elles aussi soumises à l’obligation de déclarer leurs salariés en situation de handicap. « La CFDT a depuis longtemps revendiqué cette volonté du “tous concernés”. Le fait que l’obligation d’emploi s’applique à la somme des effectifs de chacun des établissements de l’entreprise permettra d’inciter à l’effort davantage d’entreprises, d’ouvrir plus de métiers et de mieux faire connaître les solutions disponibles », commente Olivier Leclercq. Parallèlement, tout travailleur handicapé, quel que soit son contrat de travail (CDI, CDD, contrat aidé, intérim, stage, période de mise en situation professionnelle), sera pris en compte dans le calcul des bénéficiaires de l’obligation d’emploi. « Il y a tout intérêt à favoriser tous les types de contrats afin de permettre à une personne handicapée de développer des compétences en milieu professionnel et de multiplier les expériences de sensibilisation en interne. Reste à bien accompagner la personne et les collectifs de travail et préparer l’évaluation de cette mesure », observe-t-il. Lors de la concertation entamée en 2018, la CFDT avait demandé la création d’un référent handicap dans les entreprises de plus de 250 salariés. Celle-ci est désormais actée dans la loi. Ce référent aura une fiche de poste et une existence légale dans l’organisation de l’entreprise et il contribuera à informer les employeurs sur des systèmes de compensation souvent méconnus. À côté de ces bons points, la CFDT déplore des lacunes : « Le texte de loi ne fait pas du dialogue social un levier pour l’embauche des personnes handicapées et la participation des instances représentatives du personnel demeure anecdotique », regrette Catherine Pinchaut, secrétaire nationale. Dommage, car force est de constater que malgré quelques progrès ces dernières années, la loi ne suffit pas. A contrario, lorsque les représentants du personnel s’emparent du sujet, ils contribuent à faire évoluer les mentalités dans leurs entreprises : « Chaque aménagement de poste d’un salarié profite à tous les autres », souligne Pascal Anglade, secrétaire fédéral à la Fédération Conseil, Culture, Communication, chargé du handicap et du logement et vice-président de l’Agefiph (Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées). Depuis plusieurs années, il milite pour que la question du handicap soit un module à part entière dans la formation des élus et non pas quelques lignes seulement dans un chapitre sur la santé au travail.
Changer les regards
Cette volonté de porter et de développer le projet de la CFDT pour une société plus inclusive, Isabelle Ouedraogo l’incarne également au sein de la Fédération générale de l’Agroalimentaire. Chargée du dossier handicap et élue à la Mutualité sociale agricole (MSA), elle a lancé en 2015 une campagne de communication afin d’aider les équipes sur le terrain à soutenir les salariés et leurs familles. « Les élus ont toute légitimité pour intervenir en faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi. Ils peuvent aussi aborder des questions pratiques que se posent les salariés, par exemple les problèmes rencontrés par les aidants familiaux. Au congrès de Reims, en 2017, nous avons distribué des outils de sensibilisation pour faire germer des idées… Libre aux structures de les adapter à leurs différents champs fédéraux. Nous intervenons dans toutes les sessions de branches et nous sommes en train de mettre en place des référents CFDT dans les territoires. Ça commence… et on espère faire beaucoup plus. » De son côté, Pascal Anglade constate la difficulté qu’ont certaines équipes à négocier des accords handicap, la CFDT étant souvent la seule organisation syndicale à s’y intéresser. Or le handicap n’est pas un sujet mineur. « Bien au contraire ! C’est un formidable levier de syndicalisation », affirme-t-il.
La prévention comme priorité
Les acteurs du secteur le répètent : 80 % des handicaps surviennent au cours de la vie professionnelle. Depuis vingt ans, le nombre de licenciements pour inaptitude a doublé : chaque année, près de 200 000 personnes perdent leur emploi. « Pour faire baisser le taux de chômage des personnes en situation de handicap, la prévention est l’élément central de toutes les réflexions portées par la CFDT. Si la réparation a du sens, elle demeure le reflet négatif d’une vision pathogène du travail ; la prévention, quant à elle, oblige à s’interroger sur le travail, à avoir une vision prospective et positive du travail », a rappelé Catherine Pinchaut lors de son intervention à l’occasion de la mise en place du comité national de suivi et d’évaluation de la politique d’emploi des personnes handicapées (lire l’encadré). « La question du handicap est étroitement liée à celle de la santé au travail, pour laquelle nous espérons une réforme de grande ampleur. Mais je tiens à dire que ce comité de suivi et d’évaluation est une opportunité qui s’offre à toutes les parties prenantes d’échanger sur le sujet. »
